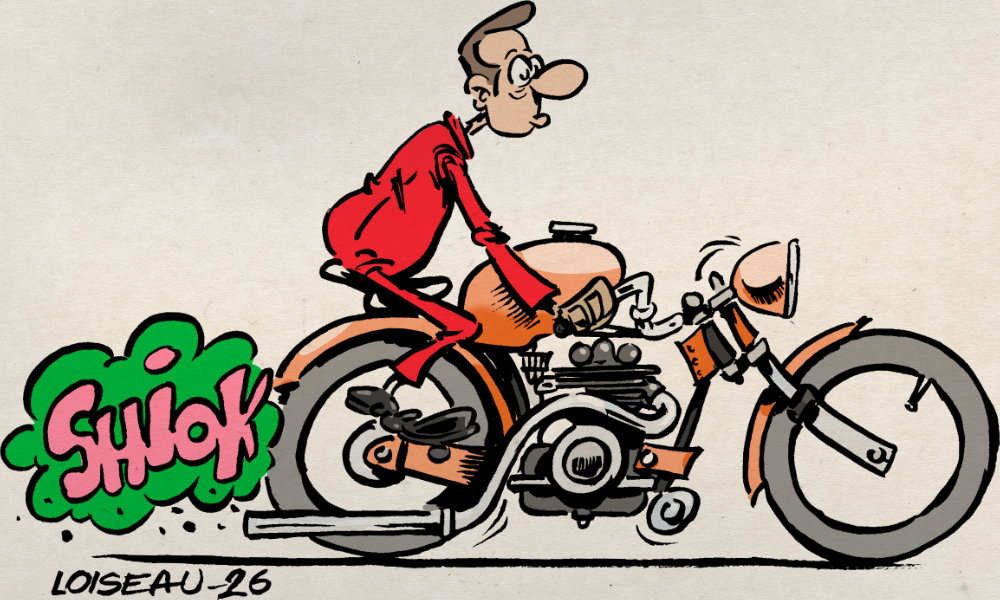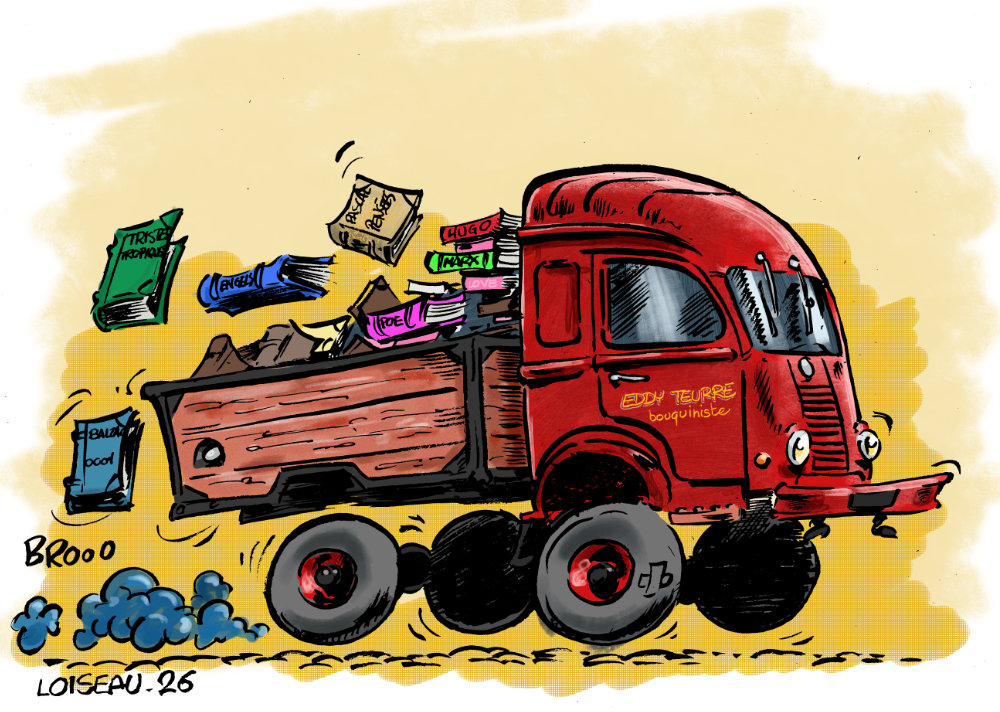J'ai eu presque la même Simca 1100. Elle était moins pimpante mais était dotée d'un moteur préparé par un mécanicien de. chez Simca, à Poissy où travaillait mon oncle. Elle a été sa voiture avant qu'il me la donne. J'ai bien aimé faire n'importe quoi avec elle et il y a prescription.